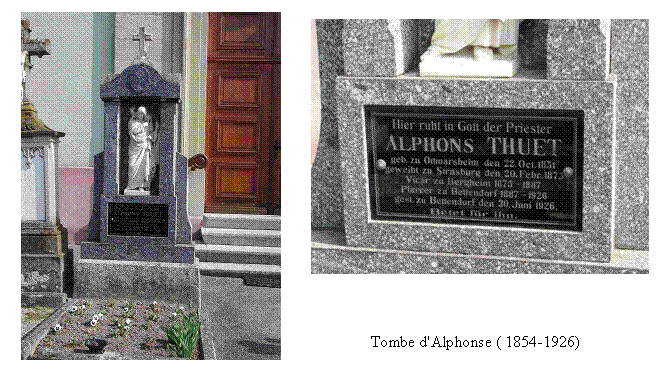Histoire et
Généalogie de la
famille
THUET de
Hammerstatt
Avertissement
Hormis le blason en couleurs, ne
sont issues du livre d'Alphonse THUET que les photos ou images en noir et
blanc. Les autres photos couleur, ou actes ont été ajoutés par les traducteurs.
Remarque concernant la
traduction
Nous avons privilégié une
traduction un peu littérale pour essayer de mieux respecter le style de
l'auteur.
Traduit de l’allemand par Christiane et
Jean-Paul THUET
Avril
2004
|
|
|
|
HISTOIRE ET GENEALOGIE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De la famille THUET
|
|
|
|
de HAMMERSTATT |
|
|
|
|
|
|
Avec prise en considération particulière |
|
des membres
ecclésiastiques |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Par ALPHONS THUET
|
|
Curé à Bettendorf ( Haut-Rhin) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1912 --- Bethsaida :
Imprimerie, Carspach (Haut-Rhin) |
AVANT PROPOS
Le 19 juin 1903 mourut au presbytère de l’auteur
à Bettendorf, la vieille tante Maria Rosa THUET. Avec elle disparut dans la tombe
le dernier rameau d’une famille nombreuse très chrétienne d’Ottmarsheim, la famille de mon grand-père. Alors qu’elle atteignit le grand âge de
84 ans, et qu’elle passa les treize dernières années de sa vie à mes côtés, je
recueillis, souvent de vive voix, d’intéressantes particularités de la vie de
ses parents, de ses grands-parents et d’autres membres de la famille. Ainsi je
me suis dit : ce serait dommage, que tous ces souvenirs relatifs à nos aïeux se
perdent, et ne soient pas connus des plus jeunes générations de la famille. Je
me suis donc mis au travail, et pendant mes moments de loisir, je cherchai à
rassembler ce que j’avais appris, et ce que je pouvais encore apprendre, non
seulement de la famille en général, mais aussi, et tout particulièrement sur
les prêtres et autres religieux, qui se sont révélés si nombreux. Le présent
livre est constitué de tout cela.
Au
début il n’était pas prévu qu’il serait aussi volumineux, mais avec
l’accroissement de la matière à utiliser, comme les lignes de l’écrivain, les
feuilles de l’imprimeur augmentèrent également. Ce livre est sans prétention
scientifique, ni culturelle, ainsi donc il n’est, bien sûr, pas pour le grand
public, mais seulement pour le cercle restreint de la famille et de ses amis.
L’objectif principal qui s’en suit, est de faire part, aux générations
présentes et futures, de l’origine et du passé de la famille, pour leur savoir
et leur identité , conformément à la belle expression des Saintes Ecritures « Quorum
intuentes exitum conversationis, imitamini fidem (~Poursuivez votre évolution selon votre
foi) ».
Je ne
dois pas oublier d’exprimer mes sincères remerciements aux personnes qui m’ont
aimablement aidé dans mon travail, et qui se trouvent généralement mentionnées
dans le livre : pourtant une mention particulière est due ici à Monseigneur le
docteur Léo FRIESS, professeur au collège épiscopal de Zillisheim, qui n’a pas ménagé sa
peine pour (parcourir) vérifier l’ensemble du travail. A monsieur le curé
WITZIG du canton de Hirsingue, pour ses
conseils et actions à mes côtés. Pour retrouver les plus vieux documents,
monsieur le chanoine INGOLD (Colmar), comme monsieur WANGER, professeur principal à Heiligkreuz (Sainte Croix en Plaine), et les
deux internes du séminaire, messieurs ALPHONS
HAEN et EMILE HIGELIN, qui m’ont rendu de précieux
services. Que DIEU leur en soit reconnaissant !
Bettendorf, le jour de la
fête de saint ALPHONSUS, 2 août 1912
L’auteur
NDLR :de nos
jours la Saint Alphonse se situe le 1er août..
ORIGINE
DE LA FAMILLE THUET
ET
SON IMMIGRATION EN ALSACE
Hammerstatt.
En Alsace, quand le randonneur
prend la route qui longe le fleuve du Rhin, face aux sommets imposants des
Vosges du Sud, entre Rumersheim et Blodelsheim, à mi-chemin environ des deux
localités, il rencontre une simple croix, placée à l’ouest de la route, et orientée
vers l’est. Cette croix fut offerte par la famille THUET en souvenir d’une
métairie qui se trouvait jadis à cet endroit, à l’est de la route, et qui
portait le nom de HAMMERSTATTER HOF.

A cet emplacement
habitaient les ancêtres de la famille THUET. La ferme elle-même était un reste
du village de HAMMERSTATT, disparu dans le passé.
Inscription
sur le socle de la statue.
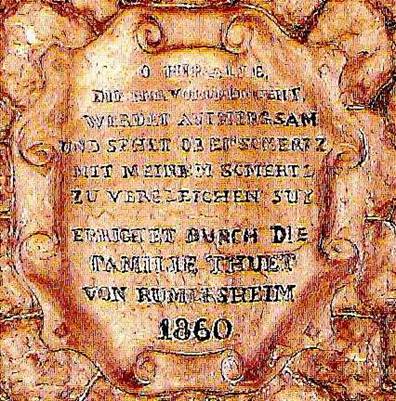
O HIR ALLE,
DIE HIR VORUBER
GEHT,
WERDET AUF MERGSAM
UND SEHET OB
EIN SCHMERTZ
MIT MEINEM SCHMERTZ
ZU VERGLEICHEN
SAY
ERRIGETET
DURCH DIE
FAMILIE THUET
VON RUMERSHEIM
1860
Déjà en l’an 730, Hammerstatt était
signalé dans l’histoire de l’Alsace : il est notamment relaté qu’à partir de ce
moment là, les propriétés de l’abbaye de Murbach en possédaient certains biens. En l’an 1441, les documents
mentionnent Hammerstatt comme un rectorat, une paroisse avec vicaire, qui
appartenait en ce temps là à la Landkapitel (direction régionale) bâloise du
Rhin, et se trouvait sous l’autorité de l’évêché. Mais trois années plus tard,
en 1444, l’endroit a dû être
détruit par les ARMAGNACS. Néanmoins d’après
d’autres documents, il devrait sa fin à des inondations du Rhin. Plus
vraisemblable peut être l’avis, qui attribue la disparition entière de la
localité, aux troubles sanglants de la Guerre de Trente Ans. L’église
paroissiale de Hammerstatt fut consacrée au saint évêque ELIGIUS (St Eloi). A l’emplacement du
village disparu, resta une ferme avec des biens importants, et une chapelle. En
l’an 1762, cette chapelle qui sans
aucun doute était dédiée à saint ELIGIUS, fut louée pour bénéfice, c’est à dire
une charge religieuse avec des revenus appropriés.
Comme il m’a été raconté de vive
voix, les ecclésiastiques (religieux) de Neuenburg auraient tenu l’office
religieux dans la chapelle.
Le Hammerstatthof avec tous ses
biens, fut donné en 1636 au collège d’Ensisheim, par l’empereur MAXIMILIEN II
et l’archiduc LEOPOLD, évêque de STRASBOURG, pour subvenir aux besoins de la
jeunesse étudiante de ce collège. Ce collège fut confié aux Jésuites en 1614.
MERKLEN écrit dans son « Histoire de la ville de Ensisheim » :
"l’Empereur MAXIMILIEN II et l’archiduc LEOPOLD, par considération
particulière pour les officiers de la Régence, et du grand nombre de nobles et
de familles de distinction, qui demeuraient à Ensisheim, procurèrent à ce
collège plusieurs bénéfices, qui devaient lui servir de dotation.
L’archiduchesse Claudia confirma authentiquement, en 1636, toutes ces
dotations, et en ajouta de nouvelles pour l’entretien de vingt-quatre
personnes : les lettres de confirmation, expédiées à ce sujet, furent enregistrées
à la Régence. Les biens qui y sont énumérés et dont le collège était en
possession jusqu’à sa suppression sont : « 1°…4° La ferme de Hammerstatt,
près de Rumersheim : cette localité incendiée et détruite par les guerres,
était un beau hameau, duquel dépendaient quatorze mille quarante ares de terres
labourables et autant d’ares en forêts et pâturages, sans compter les îles et
autres terres le long du Rhin »".
Quand en 1764 les collèges furent retirés aux Jésuites dans toute la France, les biens du collège de Ensisheim, par conséquent aussi Hammerstatt, furent transférés au collège de Colmar. Dans un livret de famille qui venait des parents de Johannes THUET, je trouvai un deuxième état des biens de Hammerstatt. Il a le titre : « Inventaire, des biens sur le ban de Hammerstatt :
|
D’abord, champs du Rhin |
191 |
|
25 |
|
|
Champs de la HART |
160 |
|
73 |
|
|
Total des champs |
351 |
Arpents |
98 |
Perches |
|
Prés du Rhin |
47 |
|
13 |
|
|
La ferme avec le jardin |
12 |
|
17 |
|
|
La HART (forêt) |
349 |
|
16 |
|
|
Le petit bois du Rhin |
17 |
|
66 |
|
|
Le total est |
778 |
Arpents |
20 |
Perches |
Extrait du plan que monsieur
BOTEN de Strasbourg a fait, retranscrit par moi, JOHANNES THUET MAYER l'ainé à
Hammerstatt –anno 1776 ans ».
Je fais
suivre plus bas, une esquisse du plan qui fut fait en 1762, et qui se trouve
aux archives de Colmar.
Tous ces biens furent perdus
pendant la (grande) Révolution. La ferme et la chapelle furent réduites en
cendres et anéanties. Les ruines et décombres furent utilisées partiellement
pour des constructions ordinaires. Ainsi peut-on voir aujourd’hui à Blodelsheim
une grange, dont les matériaux de construction émanent de Hammerstatt. Par
ailleurs peu de preuves témoignent de la splendeur passée. Sur les bornes
cadastrales des terrains des îles du Rhin, l’on trouve encore le signe des
Jésuites IHS. A part cela, rien d’autre n’a subsisté de Hammerstatt, mis à part
le nom même du territoire « Hammerstatterbann », sur lequel se trouve
la croix mentionnée plus haut.
Croquis des terres de la ferme de Hammerstatt
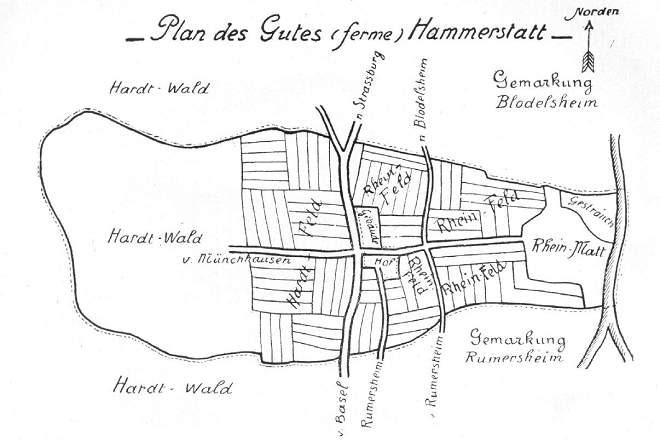
LA FAMILLE
THUET DE HAMMERSTATT
En l’an 1692 émigra de Suisse,
précisément du canton de BERNE, vers la pittoresque et riche Alsace, un certain
Hartmann THUET, qui s’installa dans la ferme et propriété citées plus haut. Il
avait à cette époque 26 ans, était célibataire, et reçu dans la même année
1692, le 25 août le saint sacrement du baptême. Le 29 juin 1699 , il se maria
avec Anna-Maria HELL, native de Hammerstatt, une fille de Peter HELL et
Anna-Maria GLASSER. De ce mariage émanèrent six enfants, à savoir :
Anna-Maria, née le 9 août 1700, dont on ne
sait rien de plus ;
Hartmann (° ?), qui se maria en 1736 avec
Franziska MEYER, et qui est sans aucun doute l’ancêtre de la famille bien
connue « Hartmann THUET » de Rumersheim;
Katharina, née le 10 mars 1705, laquelle
dut mourir enfant, car une fille suivante porta le même prénom ;
Johann Peter, né le 16 août 1706, qui se
maria en 1727 à Bantzenheim avec Katharina ONIMUS, et qui est l’ancêtre de la
famille locale assez ramifiée ;
Katharina, née le 9 février 1709, laquelle
mourut déjà le 27 février de la même année ;
Maria Magdalena, née le 17 janvier 1710, décédée
le 16 février 1712.
Le 24 mars 1713 mourut également
la mère Anna
Maria HELL, madame Hartmann THUET.
THUET (Hartmann) se maria en
deuxièmes noces, le 4 février 1717, avec Anna Maria LEHMANN de Bantzenheim. De cette
union sont issus trois fils, à savoir ;
Bartholomäus, qui mourut enfant le 2 mars
1718 ;
Johannes, né le 13 juin 1720. Ce dernier
se maria avec Maria Anna LANG de Hammerstatt, le 15 novembre 1745. Il est notre
ancêtre, dont la tombe surmontée d’une croix en pierre, est encore entretenue
dans le cimetière de Rumersheim ;
Joseph ( ° ?), qui se maria le 26 mai
1755 avec Anna
Maria RICHARD, veuve de Joseph GROTZINGER, laquelle décéda en 1763. Après le décès, Joseph se
maria avec Magdalena
LEIBY, qui mourut en 1785, lui même décédant en 1787. Il était connu sous le
sobriquet de « Grüner THUET », (THUET vert), sans doute parce qu’il
habitait dans la verdure, c’est à dire sur les îles du Rhin. Ses descendants
ont dû s’établir à Rumersheim.
L’aïeul Hartmann THUET, mourut le
10 février 1748 à l’âge approximatif de 82 ans. Sa deuxième épouse Anna Maria
LEHMANN, le suivit dans la mort le 10 mars 1752 à l’âge de 75 ans1.
La descendance.
Un coup d’œil sur l’arbre
généalogique qui accompagne ce travail, et qui me fut procuré par une experte
et habile main amie (monsieur le curé BEHRA de Heimersdorf), donne des
éclaircissements sur la large ramification de la famille citée plus haut.
L’arbre généalogique est établi rigoureusement selon les divers registres,
paroissiaux et civils, hormis les enquêtes et résultats de la ville de
Rumersheim qui souffrent de quelques manques pour cause de défaut de
documentation., mais qui sont complétés par des renseignements appropriés
transmis oralement. Nous voyons ainsi comment, la grande famille qui maintenant
s’est déployée dans toute la haute Alsace, mais particulièrement dans la région
de la Hart, à Ottmarsheim, Bantzenheim, Rumersheim et Blodelsheim, descendit du
vieux Hartmann THUET, soit à travers les deux fils des premiers mariages de Hartmann et de Peter, ou par
les deux fils des deuxièmes mariages de Johannes et Joseph. Les
THUET de Bantzenheim et les THUET-Hartmann de Rumersheim étaient issus du 1er
mariage, les autres THUET de Rumersheim et de Blodelsheim, Meienheim,
Ottmarsheim, sont des descendants du 2ème mariage. Lors de
l’évocation des quatre fils de Hartmann, Peter, Hartmann, Johannes, et Joseph, c’est
surtout Johannes qui a été mis en avant, car il était mon plus proche parent,
et sa descendance est très représentée dans la carrière religieuse.
Johannes était un fils de Hartmann THUET
et de Anna Maria
LEHMANN. Son épouse, Anna Maria LANG, était une fille de Peter LANG de
Hammerstatt. Je n’ai pas pu trouver le nom de sa mère. Le contrat de mariage de
ces époux est daté du 6 novembre 1745. Leur mariage eut lieu le 15 novembre 1745, et la
mort les sépara en 1786, par le décès du père. Leurs enfants sont tous nés à la
ferme de Hammerstatt, et sont les suivants :
1. Johannes THUET, né le 24 octobre 1746. Il se
maria d’abord avec Franziska HOFMANN, et après le décès de celle-ci, avec Magdalena RUDOLF, le 23 janvier 1769. Cette
Magdalena était une fille de Joseph RUDOLF de Baldersheim. La descendance de ce couple
THUET-RUDOLF est très nombreuse, se monte à environ 300 personnes, qui se sont
installées en différents lieux, et y sont encore, comme à Blodelsheim,
Battenheim, Meienheim et Urschenheim. Je connus personnellement un des fils de
ce couple, le « cousin Peter » aveugle. J’ai aussi beaucoup entendu parler
du « cousin
Hans », qui était également un fils de cette famille qui comptait cinq
fils et cinq filles. Deux des cinq fils allèrent à Blodelsheim, Franz-Joseph et Ignatius, un à
Meienheim, Elogius, duquel
descend la famille THUET de Urschenheim, deux restèrent à Rumersheim, ceux
cités plus haut, cousins Hans et Peter. Peter resta célibataire.
Johannes mari de Elisabeth GREDA, est
l’ancêtre fondateur de la famille à Battenheim, Fessenheim, et
Sainte-Croix-en-Plaine. Les cinq filles se marièrent à Blodelsheim :
Katharina (épouse SITTERLE Célestin) parents
de SITTERLE Clemens
Magdalena (épouse LINDER Blasius,
beaux-parents de la famille JUDAS, puis épouse HASSLER Dominique).
Franziska (épouse SITTERLE Amand).
Maria Anna (épouse FIMBEL Joseph).
Anna Maria (épouse GROTZINGER Johannes).
2. Franz Elogius THUET, né en 1758, se
maria avec Elisabeth
REIDINGER de Bantzenheim en février 1783. Il fut d’abord fermier au
Hammerstatterhof, puis s’installa à Rumersheim, où pendant la période de la
Révolution, il fut maire pour les affaires religieuses et des ordres. Mais pour
cela il fut beaucoup poursuivi. Les circonstances de sa mort furent tragiques.
Les agents de la Révolution se présentèrent jusque devant son lit de malade,
pour le traîner devant le tribunal révolutionnaire. Ce n’est qu’à cause de sa
grave maladie, dont les suites entraînèrent sa mort (20 mars 1796), qu’il
échappa à un sort terrible. Sa femme, Elisabeth REIDINGER, était une fille de Stephan REIDINGER, maire
de Banzenheim, et de Maria Anna SCHNEBELEN. Elle était née en 1750 et vécut jusqu’en 1830. Comme
parentés elle avait cinq frères et deux sœurs, à savoir :
Stephan (père de
madame VIRELL à Breisach, de madame SCHEUCH à Herlisheim, et grand-père de
madame WIESSNER de Briesach),
Johann
Michael,
Johann Georg
Sebastian, qui devint religieux,
Anton,
Maria Anna (madame
SEILER Michael à Banzenheim) et
Franziska (madame NICO
Joseph de Rixheim).
Madame Elogius THUET, fut remarquable par ses vertus, tant chrétiennes
que domestiques. Durant son long veuvage, elle éduqua ses enfants de façon
exemplaire. J’entendis souvent des louanges à son égard de la bouche de ma
tante. Elle avait quatre fils et deux filles.
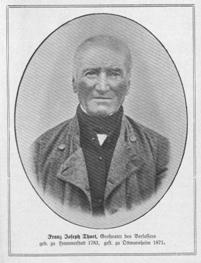 L’aîné
des fils, mon grand-père, s’appelait Franz-Joseph, naquit fin 1783 ou début
1784 à
Hammerstatt, et vécut jusqu’au 3 janvier 1871. Il se maria à
Ottmarsheim, avec
Elisabeth LUSSY, fille de Johannes LUSSY et Margaretha WELTER. Elle lui fit don de treize enfants, dont plusieurs
moururent en bas âge. Parmi les survivants trois entrèrent dans les ordres,
trois se marièrent, pendant que les autres restèrent célibataires. Le dernier
membre de cette famille, ma tante Maria Rosa THUET, décéda chez moi dans mon
presbytère de Bettendorf, le 19 juin 1903 à l’âge de 84 ans. Le couvent d’Ottmarsheim
n’est pas peu redevable de son existence et de sa pérennité, au caractère
bienveillant et charitable de ces deux époux très chrétiens, Fr. Joseph THUET
et Elisabeth LUSSY. D’eux descendent les familles THUET d’Ottmarsheim, Petit
Landau, et Blotzheim.
L’aîné
des fils, mon grand-père, s’appelait Franz-Joseph, naquit fin 1783 ou début
1784 à
Hammerstatt, et vécut jusqu’au 3 janvier 1871. Il se maria à
Ottmarsheim, avec
Elisabeth LUSSY, fille de Johannes LUSSY et Margaretha WELTER. Elle lui fit don de treize enfants, dont plusieurs
moururent en bas âge. Parmi les survivants trois entrèrent dans les ordres,
trois se marièrent, pendant que les autres restèrent célibataires. Le dernier
membre de cette famille, ma tante Maria Rosa THUET, décéda chez moi dans mon
presbytère de Bettendorf, le 19 juin 1903 à l’âge de 84 ans. Le couvent d’Ottmarsheim
n’est pas peu redevable de son existence et de sa pérennité, au caractère
bienveillant et charitable de ces deux époux très chrétiens, Fr. Joseph THUET
et Elisabeth LUSSY. D’eux descendent les familles THUET d’Ottmarsheim, Petit
Landau, et Blotzheim.
Le 2ème fils d’Elogius reçu le prénom de Stephan. Il naquit
en 1785, sans doute à Hammerstatt, se maria à Rumersheim le 6 février 1809 avec Rosa Katharina GROTZINGER, fille
de Johannes
GROTZINGER et Maria Anna HOFFMANN, et mourut à Rumersheim le 20 novembre 1845. Il
laissa derrière lui une famille nombreuse avec 8 filles et un fils Ferdinand qui vint
à Heiteren, et qui est l’ancêtre de la famille THUET de cet endroit là. Parmi
les filles, deux se marièrent à Neuenburg (Bade), à savoir Joséphine (madame MAIRE), et Eléonore (madame WEISS Aloys) ; deux
restèrent à Rumersheim, Marie Elisabeth (madame GROTZINGER Xaver, mère de feu le curé Xaver
GROTZINGER), et Justine (madame HUG Peter); une
vint à Fessenheim, Marie Antoinette (madame BADER) ; une autre à Altkirch, Luise (madame RIETSCH) ; deux
moururent célibataires à Rumersheim, Leogadie et Maria Rosa.
Le 3ème fils d’Elogius THUET et de Elisabeth REIDINGER, est Franz Johann Georg1, très
certainement également né à Hammerstatt en 1787. Celui-ci maria le 27 avril 1813 une Margaretha LANG
d’Ottmarsheim, fille de Konrad LANG et Margaretha WIESLER, habita alors à Rumersheim, ou il mourut le 1 décembre 1846.
Il ne laissa après lui qu’un fils Franz Ludwig THUET (1814-1889), mari
de Katharina
FUCHS de Obersaasheim (1823-1896).
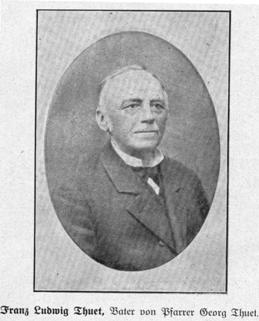

Johann Georg et son
fils Franz
Ludwig se distinguèrent par de magnifiques réalisations pour le
culte, qui eurent des conséquences sur leur descendance, puisque deux membres
choisirent d’entrer dans les ordres : Georg THUET, curé de Tagolsheim, et Joseph THUET,
P.Marinus,
trappiste à l’Oelenberg
; un autre Edmund, devint médecin, et les autres, Albert, Eugen, et deux
sœurs, conduisirent la maisonnée paternelle. La famille ne s’est pas développée
en dehors de Rumersheim.
![]()
Fr. Johann Georg était très
maladif, et de ce fait ne put effectuer de travail pénible. Ainsi il s’occupa
de travaux d’arts plus légers, dans lesquels il atteint un haut degré de
perfection. On peut encore admirer ses œuvres aujourd’hui grâce à plusieurs
objets domestiques conservés par la famille, et particulièrement le beau tronc
qui dans l’église de Rumersheim sert de support au cierge pascal. Avec cela Fr.
Johann Georg était doué pour amuser son entourage avec des blagues
spirituelles.
Ci-dessous le tronc cité et le détail du socle initiales TG, et l'année de fabrication 1838 sous la rosace supérieure.





Le 4ème enfant de la
famille THUET-REIDINGER était une fille, appelée Maria Anna, sans doute aussi née à
Hammerstatt en 1789. Elle
est morte célibataire à Rumersheim en 1874 où elle repose en profonde piété.
Xaver, le 5ème enfant et 4ème
fils, est né en 1792, à
Hammerstatt ou à Rumersheim, la question reste posée. Mais il vécut à
Rumersheim jusqu’en 1860. Depuis le 27 décembre 1821 il fut marié à Maria Anna, sa cousine, fille de Johannes THUET et Elisabeth GREDA. Ces
excellents époux chrétiens avaient trois fils et trois filles. Deux filles se
consacrèrent à la religion, l’une dans l’enseignement, l’autre au service des
malades. Un fils Eduard, devint
prêtre et mourut en étant curé d’Oltingue. Les deux autres fils se marièrent ;
l’un, Ludwig, à
Biesheim avec Anna Maria BUTZ (parents de Joseph, celui qui mourut en Afrique en
tant que père blanc) ; l’autre, Aloys, à Rumersheim avec Margaretha THUET, sa
cousine d’Ottmarsheim. La troisième fille, Elise, décéda célibataire à
Rumersheim.
Le 6ème et dernier
enfant de la famille THUET-REIDINGER naquit à Rumersheim en 1795, eut le
prénom de Maria
Rosa, et devint l’épouse de Johann-Baptist HEIMBURGER de
Fessenheim, fils de Franz Xaver HEIMBURGER et Theresia WALTER. Cette madame HEIMBURGER a dû vivre de façon très
vertueuse, et donner à ses quatre fils et deux filles une bonne éducation. Les
deux filles sont mortes célibataires à Fessenheim. Des quatre fils, l’aîné Xaver, alla à
Rouffach où il se maria avec Emilie CALLINET. Le 2ème, Franz Ludwig, resta à
Fessenheim et se maria avec Katharina BELLIKAM. Le 3ème, Johann-Baptist, se maria également à
Fessenheim avec Maria
Anna FIMBEL. Le 4ème, Joseph, partit à Oberenzen, où il prit
pour femme, Maria
Katharina RICH. Un fils de ces époux HEIMBURGER-RICH entra dans les ordres, devint
jésuite et œuvra comme missionnaire sur l’île de Ceylan.
Remarquable est le fait, que tous
les enfants mariés de la famille THUET-REIDINGER, comptent des prêtres dans
leur descendance. Sans doute une récompense pour la foi inébranlable d’Elogius
pendant les mauvais jours de la « grande » Révolution. Honneur au
souvenir de ce brave chrétien ! Son glorieux prénom fut perpétué dans la
famille ; sauf qu’on fit d'Elogi, Louis, d’où les nombreux Franz-Ludwig qui se
trouvent dans la famille.
3. Maria Anna THUET, une fille de Johannes THUET et
Maria Anna LANG, est certainement née à Hammerstatt le 27 janvier 1749. Elle se
maria avec Christopher
BICHELEN, instituteur à Eschenzweiller. Ce mariage a dû avoir lieu
en 1773 ou 1774. Dans
les registres paroissiaux de Eschenzweiller sont inscrits neuf enfants de ce
couple, à savoir : Maria Anna, née en 1775, morte en 1795 à Eschenzweiller ; Elogius ; Alexander, né en 1782 ; Anna Maria Ludmina, née en 1784 ; Benedikt Dominik
Salomon, morte en 1786 ; Franz Anton, né en 1788 ; Maria Theresia, née en 1789 ; Franziska, née en 1793, morte à
9 mois ; Franz
Anton mort le 8
juin 1794.
Un examen des registres
paroissiaux à Eschenzweiller a conduit aux renseignements suivants concernant
la famille. Le père, Joseph Christopher BICHELEN né à Eschenzweiller le 24 mars 1747, était
un fils de
Franz BICHELEN et de Eva BINDER. Il était instituteur et officier public à Eschenzweiller
jusqu’en
4. Franziska THUET, fille de Johannes THUET et Anna
Maria LANG. Une date exacte de sa naissance ne peut être donnée, à cause des
lacunes dans les vieux actes de baptêmes de Hammerstatt. Cependant, il est invraisemblable
qu’elle soit née en 1750. Elle s’est mariée le 5 mai 1780 avec Franz Joseph Rudolf, maire
de Blodelsheim. Les renseignements qui me furent fournis sur la famille Rudolf-Thuet divergent selon le cas.
D’après les dires il paraît que ces époux restèrent sans descendance, et que
Rudolf après le décès de Franziska contracta une deuxième union avec une
personne de Blodelsheim, laquelle resta aussi sans enfant. D’après une autre
information il se raconte que Franz Joseph RUDOLF et Franziska THUET ont laissé
un fils qui mourut en Russie en tant qu’officier de l’armée de Napoléon I. Ce
fils devait s’appeler Joseph, et avoir été un excellent soldat. Cette dernière
information a dû venir du cousin Peter.
5. Anna Maria THUET, fille de Johannes THUET et
Maria Anna LANG, est née à Hammerstatt le 9 février 1751. Elle se maria en 1784 avec Romanus LOETSCH, citoyen
d’Ensisheim. Le fils unique de ces époux, Johannes LOETSCH, maria à Ensisheim le 29 février 1808, Anna Maria FREY, fille
de Bernard FREY et Maria Anna BRAUN. De
cette union sont issus deux fils et trois filles, à savoir : Johann Georg, le
futur provincial des Frères de Marie, dont l’histoire suit plus bas ; Franz Xaver, qui
mourut sans enfant;
Maria Franziska et Maria Katharina (des jumelles), et Maria Anna. Toutes les trois filles
endossèrent l’habit religieux et entrèrent dans la congrégation des Sœur de
l’Ecole de Rappoltsweiler. Maria Franziska reçu le nom de Sr Fabienne
(1817-1868), Maria Katharina Sr Marcelline (1817-1894) et Maria Anna Sr Venceslas
(1826-1902). Avec elles toute la descendance de Anna Maria THUET s’est éteinte.
6. Katharina THUET, fille de Johannes THUET et
Maria Anna LANG. Née à Hammerstatt entre 1761 et 1765, Sebastian RIBER de
Meienheim la maria le 26 août 1788. Trois enfants sortirent de cette union : un fils, Franz Joseph RIBER, qui
mourut enfant, et deux filles, Maria Katharina et Maria Rosa. Maria Katharina, née le 14 novembre 1789, épousa
le 13 août
1813, Johannes RIBER. Leurs descendants vécurent à Meienheim. Maria Rosa, née le 15 février 1794, fut
ramenée à Ungersheim comme épouse par Georg MEYER, le 3 août 1813. Leur
fille Maria
Anna devint madame Joseph GANGOLF à Habsheim. Maria Rosa décéda déjà le 2 décembre 1817.
7. Franz Joseph THUET, le plus jeune enfant de
Johannes THUET et Maria Anna LANG, naquit à Hammerstatt en 1766. Il
entra dans les ordres et fut curé de Rumersheim. Il sera question de lui dans
un paragraphe plus loin.
Les détails et explications
présentés, et un coup d’œil sur l’arbre généalogique de la famille Johannes
THUET-LANG vont nous montrer la grande extension qu’a atteint toute la famille
THUET de Hammerstatt. En complément je voudrais encore évoquer certains points
généraux se rapportant à l’origine, aux traits de caractères, et à la religion de
la famille.
ORIGINE, CARACTERE, et RELIGION.
Sur l’origine du premier Hartmann
THUET de Hammerstatt aucun autre document n’existe que les quelques mots qui
sont inscrits dans le registre des mariages : « Ex ditione
Bernensi… » (du protectorat de Berne). Le protectorat de Berne s’étendait
à l’époque, en 1692, jusqu’aux cantons de l’Argovie y compris. Pour recueillir
de plus amples renseignements sur la patrie des ancêtres des THUET, par
l’aimable intermédiaire de Monsieur Cousin WANGER, directeur d’école à Sainte
Croix en Plaine, je me suis adressé à plusieurs localités de cette région de
Suisse, c’est à dire, à Sempach, Zofingen, Sengen, Oberensfelden, toutes des
localités pouvant entrer en ligne de compte, car la famille des THUET a dû y
être très représentée. Mais d’une façon ou d’une autre aucune réponse
satisfaisante n’a pu être fournie. Une chose est certaine concernant l’ancêtre
suisse de la famille, il vint de la région de Berne. D’ailleurs ceci est
confirmé par une ancienne tradition familiale. De tout temps il se disait que
la famille venait de Suisse, mais que la rumeur parlait non pas d'un, mais de
deux Suisses, d’ailleurs deux frères qui venaient de la région de Berne, dont
l’un alla habiter à Hammerstatt, l’autre à Ammerschweier. Il est difficile
d’admettre cette interprétation. Je crois plutôt qu’en la circonstance le
descendant THUET a contracté deux mariages. Dans ces conditions il y avait deux
sortes d’héritiers, que l’on transforma plus tard en deux familles différentes.
Malgré cela la difficulté subsiste et l’énigme de savoir si la famille THUET de
Ammerschweier est liée à celle de Hammerstatt est non résolue.
Les documents de la famille
THUET- Ammerschweier sont plus clairs et précis que ceux parcimonieux de
Hammerstatt. Mais ils n’offrent pas d’indications par lesquelles on pourrait à
l’origine fusionner les deux familles. D’après le registre des mariages,
Hartmann est venu de la région de Berne en 1692 pour s’établir à Hammerstatt.
Il avait à l’époque 26 ans. Douze années plus tard, en 1704, vint de Kirchbühl près de Sempach à Ammerschweier, un jeune
homme nommé Martin THUET. Celui-ci était un fils de Michael THUET et Dorothéa
WANDLER, et était citoyen de la
ville de Sempach. Avant qu’il quitta ce lieu, il vendit à son frère Joseph, sa
part de patrimoine paternelle et maternelle. C’est ce que disent les documents
conservés à Ammerschweier. Comme Hartmann à Hammerstatt, Martin fonda la
famille THUET de Ammerschweier. Etant donné que dans les vieux documents ou les
écrits familiaux il n’est pas question de relations amicales ni de rapports
familiaux entre ces ancêtres Hartmann et Martin, ou entre leur descendance, le
doute est justifié et de penser qu’ils
n’étaient pas frères mais seulement parents rapprochés. Il n’est pas peu
réjouissant pour moi de pouvoir souligner ici, que la famille
THUET-Ammerschweier compte également dans son giron d’excellents prêtres, et
que leur brave aïeul Martin, apporta avec lui un certificat « de jeune
homme, pieux, honnête, modeste, et honorable » de l’hôtel de ville de
Sempach.
Il y a encore une troisième
famille avec le nom de THUET, laquelle s’étend jusqu’au début du 17ème
siècle, et qui s’implanta notamment à Gundolsheim, Issenheim, et Ensisheim.
Il est frappant que notre ancêtre de Hammerstatt porte le
prénom de Hartmann comme surnom, ou nom de baptême. On pourrait presque penser
qu’il avait ce prénom parce que venant dans la région de la Hardt, soit d’abord
en se l’appropriant, soit en se le faisant attribuer après qu’il se soit
installer à Hammerstatt dans la Hardt. Ce serait d’autant plus vraisemblable,
si on veut prêter foi à la rumeur qui s’était rependue dans la famille, d’après
laquelle Hartmann aurait été protestant. De toute façon la région dont Hartmann
était originaire était en grande partie protestante ou calviniste. Mais comme
par ailleurs Hammerstatt dépendait du collège de jésuites de Ensisheim, on peut
admettre le fait, que le locataire protestant ait été converti à la foi
catholique par les efforts des hommes de l’ordre des jésuites d’Ensisheim, et
fut baptisé du nom de Hartmann. Hartmann est d’ailleurs le nom d’un Saint du 12ème
siècle qui mourut évêque de Brixen dans le Tyrol et dont la fête tombe le 23 décembre. Mais il ne s’agit dans ce dernier
cas que de suppositions et d'hypothèses, qui se perpétuent dans la famille,
mais qui jusqu’à aujourd’hui n’ont pas été confirmées par des documents.
Sur un petit morceau de papier,
lequel est conservé par les archives de Strasbourg, qui n'est qu'un extrait
d’un ancien registre paroissial de Rumersheim, est écrit ce qui suit :
« Anno 1692, 25. Augusti, confirmati sut : Hartmann Thuet ex
Hammerstatt, cujus patrinus fuit Quirinus Rietsch. » c.q.v.d. :
« En l’An 1692, le 25 août, fut confirmé : Hartmann Thuet, dont le
parrain était Quirinus Rietsch ».
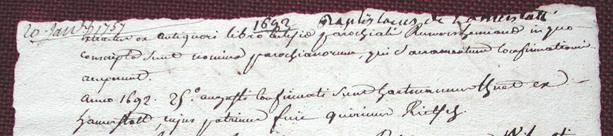
Que la confirmation de cet homme
dans sa 26 ème année était le résultat d'une conversion au catholicisme juste
auparavant reste à être prouvé. Il est toutefois à remarquer que les actes de
mariages aussi bien de Hartmann que de ses fils sont rédigés dans un sens
catholique. Celui de Hartmann, l'aîné, est très court : "le 29 juin 1699,
Hartmann THUET du territoire de Berne, à Hammerstatt depuis 1692, et Anna-Maria
HÖLL de Hammerstatt". Les actes de mariage de ses fils sont rédigés d'une
façon plus solennelle, ainsi celui de Johannes avec Anna-Maria LANG mentionne :
"Premièrement les futurs époux doivent et désirent conserver et maintenir
les saints sacrements qui leur ont été dispensés à l'occasion de leur mariage.
De même ils font la promesse de vivre chrétiennement et comme il est de coutume
dans la religion catholique de recevoir à la première occasion les saints
sacrements de la confirmation. De même dans le contrat de mariage de Joseph le
fils de Hartmann (1755) il est question " d'un usage catholique et
apostolique des saints sacrements de la bénédiction divine ". Paroles qui
témoignent des sentiments profonds d'esprit religieux et d'une foi profonde.
Sur la base de la mentalité des
fils j'adhérerais volontiers à l'idée que leur père Hartmann n'avait jamais été
protestant mais catholique. Peut-être a-t-il de ce fait quitté la Suisse
protestante pour éviter le danger d'apostasie (ndlr : reniement du catholicisme
au profit du protestantisme dans ce cas), pour trouver en Alsace catholique
plus de sécurité pour sa croyance. Il trouva effectivement cette sécurité à
Hammerstatt sous la protection des Jésuites. La famille THUET-Hammerstatt
remercia sans aucun doute ces honorables hommes de l'ordre, par sa fermeté et
sa fidélité en la foi catholique. De tout temps la foi et la religion furent de
précieux héritages entre les membres de cette famille. Que ceci veuille rester
ainsi est le vœux le plus fervent de l'auteur. C'est pour cette raison
essentiellement que je me suis donné la peine d'énumérer simplement les
prêtres, religieux, et missionnaires, qui ont émanés de la famille, et de
raconter brièvement leur vie et leur œuvre.
Mais auparavant quelques mots sur
le caractère de la famille THUET, qui depuis le Moyen-Age a joué un rôle
important, voire héroïque dans son pays d'origine.
Le nom de THUET n'est pas inconnu
dans l'histoire de la Confédération Helvétique. Il est lié à un certain nombres
de faits héroïques lors des combats dans les temps anciens pour la libération
du peuple et sol suisse. Dès le début de la Confédération il est question de ce
nom. Ainsi durant la seconde moitié du 14ème siècle vivait à
Zofingen dans le canton d'Argovie, un certain Niklaus THUET (ndlr: THUT). Il
était maire de la ville et en cette qualité porte-drapeau de la bannière de
Zofingen lors de la bataille près de Sempach (9 juillet 1386). Blessé à mort
c'est avec ses dents qu'il la tint jusqu'à la fin. Depuis ce temps tous les
maires de Zofingen doivent faire le serment de défendre leur bannière, comme le
fit le brave maire Niklaus THUET. Dans la revue annuelle "Histoire ,
Langue et littérature en Alsace-Lorraine" 12ème siècle, page
46, édité par "la branche Histoire-Littérature du Club Vosgien", nous
lisons le poème suivant qui loue et chante le fait historique. Le titre dit :
Das Turnier 1383.
Traduction de M.Dr Kurt SIEGFRIED de Zofingen (année 1973).
Le tournoi
Vieux – Zofingue présente une
charmante image
Près de l'Aar sur le champ
couvert de fleurs.
Les chevaliers s'ébattent avec
lance et bouclier
Les chevaux fortement
protégés.
Pour la
fête du tournoi
La foule
se portait en masse,
De la Suisse, de l'Alsace et
de l'Allemagne,
Ainsi le veut le Sieur
LEOPOLD.
L'épouse du duc sur le balcon
élevé
Entourée de dames ravissantes
Prépare les couronnes dignes
De couronner le front du
vainqueur
Bien des
poitrines ici se soulèvent
Avec un
sentiment d'envie
Et quand-même une hésitation
excusable
D'oser lutter pour la
couronne.
Et à côté de la tente
couverte de rouge
Le bourgmestre monsieur THUET
Parmi les invités d'honneur
de Zofingue.
Son attention se pose
compréhensible
Avec un
sentiment de plaisir
Sur la
foule bariolée
Qui formée somptueusement et
vigoureusement
Se déploie devant les regards
admiratifs.
Et le duc fait signe: le jeu
commence
Avec l'appel retentissant des
fanfares
La lance vise comme but le
bouclier de l'adversaire
Et les couples courageux
s'élancent
Avec force
La lance
craque
Les bois éclatent
Et les chevaliers volent
parterre.
Un seul reste dans la selle
Quand tous les autres
trébuchent et tombent
DA PORTA, un seigneur
étranger du midi
Semble conserver la victoire
devant tous
Comme
chacun s'affaisse,
Le duc
LEOPOLD fait signe
A un vieux chevalier
d'assister
Celui-ci se prépare en hâte à
la lutte.
Le sieur GUTEROLF appelle
monsieur THUET et demande:
" Dites-moi ! comment
appelez-vous le vieux
Qui se risque à la lutte
inégale avec le Milanais?
Il ne remportera jamais la
victoire."
Monsieur
THUET répond:
"
Vous ne le connaissez pas!?
Il suffit de mentionner le
Maltais
Et tout le monde le
reconnaît.!"
Est-ce lui le petit enfant
abandonné
Qu'on a retiré jadis du Rhin?
Auquel les dieux de la chance
sont dévoués
Et les grands de la terre
acquis?
Qui par le
pouvoir de l'empereur
A été fait
baron
Qui a atteint la noblesse
suprême
En recevant comme épouse une
comtesse?
Le Maltais saute agilement à
cheval
Et se dresse dans les étriers
Ils baissent les lances pour
assurer le coup
Et saisissent les brides
pendantes
Et se
précipitent
Dans un
fracas impétueux.
Les chevaux trébuchent et
tombent
Ainsi l'étranger tombe à la
renverse parterre.
Et dans le champ s'élèvent
bruyamment
Les appels enthousiasmés de
la foule.
Accompagné par le duc notre
héros reçoit
Au bas des marches du trône
élevé
Le gage du
vainqueur
De la main
de la duchesse
Et les yeux bienheureux de
son épouse
Se plongent profondément dan
son âme.
Les amis du Milanais se
taisent fâchés
Seul Guterolf, chevalier de
Dornach,
Mis en colère au plus profond
de son âme
Crie au chevalier dans une
rage furieuse
"Prends
garde! Prends garde!
Cela
viendra du jour au lendemain
Et tu devras t'apercevoir
avec effroi
Si c'est prudent d'avoir confiance en la chance
La bataille de Sempach a eu lieu
entre l'Archiduc d'Autriche Léopold III et les confédérés de Suisse, ces
derniers remportant la victoire. Léopold y a perdu et la victoire et la vie,
mais également les Zofingois eurent à déplorer la mort de leur maire THUET,
lequel périt héroïquement dans la mêlée. A cette époque Zofingen devait marcher
aux côtés des Autrichiens. Cette mort héroïque fut chantée dans un autre poème
dont le cousin monsieur August Thuet, curé de Grenzingen m'a fait part.
Niklaus
Thuet.
Gen
Sempach zog für Östreichs Macht
Zofingens
Fähnlein in die Schlacht ;
Das
Fähnlein aber trug mit Mut
Voran
der Schultheiss Niklaus Thut.
Bald
war mit Schwert und Hellebard
Ihr
Harst um Leopold geschart ;
Bald
standen sie zum heissen Streit
Im
grünen Wiesengrund gereiht.
Bald
brachte aus der Waldes Nacht
Der
Feind die wilde Männerschlacht,
Bald
schien dem Adel, fest gekeilt,
Glorreich
schon gar der Sieg ereilt.
Da
kam der Eidgenossen Heil,
Struht
Winkelried, und brach den Keil.
Er
sprang in Östreichs Speerwald ein
Und
riss den Seinen Bahn darein.
Un d
wie ein Blitzschlag fuhr sogleich
Der
Tod in's Herz von Österreich.
Und
Eich' auf Eiche schlug er hin,
Kein
Schild, kein Panzer hemmte ihn.
Und
selbst der Herzog hochgemut
Dank
sterbend in sein junges Blut.
Doch
in des Kampfes höchster Glut
Stand
immer noch der Schulyheiss Thut.
Er
stand als wie ein Riesenturm
Und
hielt sein Fähnlein fest im Sturm;
Und
um ihn, trotzend der Gefahr,
Stritt
hüngleich seine treue Schar.
Doch
alles schwebt zuletzt und fällt;
Er
steht von allen losgeschält.
Da
trifft der grimme Tod auch ihn;
Er
stöhnt und stürtzt auf Fähnlein hin.
Und
röchelnd reisst er's noch vom Schaft,
So
retten es der Bürgerschaf.
Tags
drauf da zieht man klagend aus,
Holt
seine Toten still nach Haus.
Man
fand die ganze treue Schar
Gefällt,
wo sie gestanden war.
Der
Schultheiss lag im Blut gesumpft,
Das
Schwert bis an die Faust gestumpft;
Und
in der Linken hielt mit Kraft
Gefäustet
er des Banners Schaft.
Allein
das Banner misste man
Und
fand dafür sein Blut daran.
So
werden sie nach Haus geführt
Und
schlicht mit Kranz und Kreuz geziert.
Man
trägt bei Sang und Klockenklang
Die
Mann für Mann die Stadt entlang.
Man
stellt sie all'ins Totenhaus
Zu
öffentlichen Ehren aus;
Und
klagend widerhallt's im Thor,
Dass
Haupt und Banner man verlor.
Drauf
hielt der Weibel treu die Nacht
Bei
seinem Schultheiss Leichenwacht.
Der
schlief auf seiner Totenbahr,
So
schön im grauen Bart und Haar.
Er
sah den Herren weinend an,
Vom
dem er einst so fiel empfahn.
Er
strich den Bart ihm und den Mund,
Auf
dass er ihn noch küssen kunnt!
Da
nahm er, siehe! Wunderbar
Im
blassen Mund ein Tüchlein wahr.
Er
fasst es an, er zieht's hervor,
Er
schaut es an, er hält's empor.
Er
ruft, als er das Wappen sah:
"Glück
auf, das Banner ist noch da ! "
Gesungen
ward's in Spruch und Reim:
"Der
Schultheiss bracht's im Munde heim."
Sogleich
vernahm von Tor zu Tor
Die
frohe Runde jedes Ohr;
Und
stauned lief die Stadt herbei
Und
pries des Bannerherren Treu.
Und
noch erzählt sich's jung und alt
Dass
jeder treu des Amtes walt;
Und
ob er hoch, ob niedrig steh',
Wie
Niklaus Thut zum Fähnlein seh'.
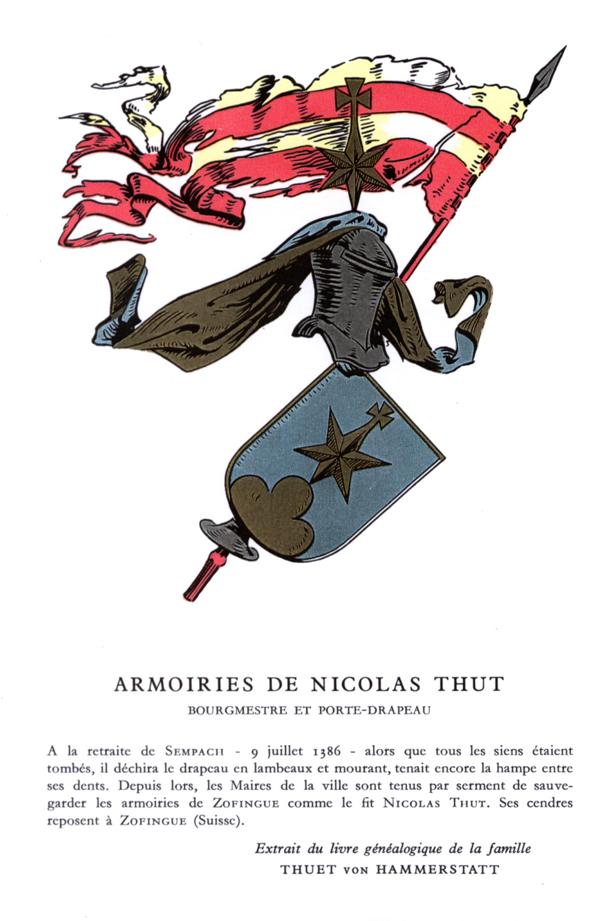

Statue de Niklaus THUT sur la place centrale de
ZOFINGEN.
Il semble que la bravoure et le
courage de ce valeureux combattant Niklaus Thuet se soient en grande partie
transmis à sa descendance. Notamment les anciens de la Famille Thuet, nos
ancêtres, étaient tous plus ou moins enclin à la bagarre et étaient de
courageux combattants. Rien que le fait de s'expatrier, quitter sa Suisse
natale pour venir comme locataire s'installer dans une ferme isolée à proximité
de la grande et inhospitalière forêt de la Hardt, et des vertes îles du Rhin
prouve un esprit d'entreprise peu commun. De leur esprit de liberté et
d'indépendance émane un penchant pour les jeux, et leur passion pour la chasse,
la pêche et autres. Plusieurs d'entre eux y eurent une grande habileté et
devinrent des chasseurs émérites.
Un membre de la famille, Ludwig
Thuet de Biesheim, prit part au siège de Breisach en 1870 à la tête d'une
section de la garde nationale des troupes régulières allemandes. Au cours d'un
combat il fut grièvement blessé, et mourut des suites de ses blessures. Un autre
Thuet de Meienheim, Anton Thuet, fut tué en
1831 par un coup de sabot d'un cheval sauvage qu'il essayait de mater.
Mais cette intrépidité ne les empêchait pas de bien soigner leurs champs.
Au début du livre j'ai déjà
présenté l'étendue des biens qui appartenaient à la ferme de Hammerstatt. En
prenant ensemble en bail ces propriétés rurales et immobilières, ils les
gérèrent tellement bien qu'ils purent acquérir à côté, des propriétés
personnelles qu'ils firent fructifier. Aussi en peu de temps il arriva que
Johannes le fils du vieux Hartmann n'était pas seulement fermier locataire de
Hammerstatt, mais devint également citoyen et propriétaire de Rümersheim. A la
mort de ce Johannes qui survint en 1786, époux de M.Anna Lang, il fut dressé un
inventaire des tous ses biens et avoirs en vu du partage entre ses sept enfants
cités plus haut.
De cet inventaire, que j'avais à
disposition (ndlr:voir page suivante), il ressort que Johannes et M.Anna Lang
avaient deux exploitations agricoles séparées, l'une en tant que locataire à
Hammerstatt, l'autre en tant que propriétaire à Rümersheim.
La propriété de Rümersheim se composait d'une
maison d'habitation avec ferme, étables, grange, prés et jardin potager. C'est
sans aucun doute la ferme où récemment en 1910 est décédé Alois Thuet. La
vieille maison est maintenant remplacée par une nouvelle, qui certes est belle,
mais n'égale pas en robustesse l'ancienne. Enfant, j'ai toujours admiré les
murs monumentaux de la vieille maison, qui avaient au moins une épaisseur de un
mètre. A cette maison et ferme étaient liés une location de 28 arpents de
champs qui rapportaient en loyer à l'église de Rümersheim trois viertel (ndlr :
1 viertel = 6 boisseaux = ~78litres ) et trois sesters de seigle et autant
d'orge. Appartenaient également à la maison 2 arpents communaux, au total donc
30 arpents en location. Cette demeure fut transmise à titre personnel par les
époux Johannes Thuet-Lang à leur fils Elogius Thuet-Riedinger par contrat de
mariage du 4 février 1783, moyennant une somme complémentaire de 3300
(tournois) francs payable en 4 annuités successives.
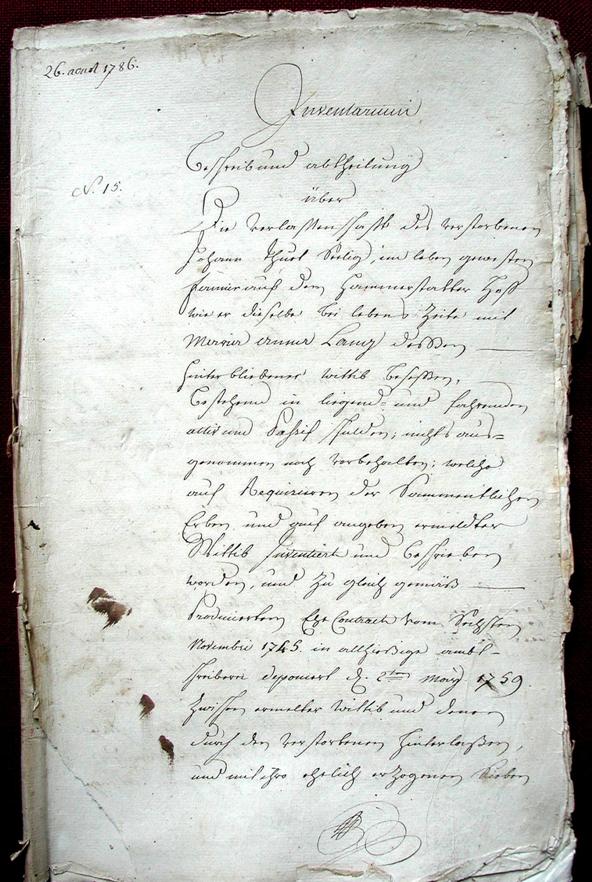
Inventaire
des biens de Johannes et Maria
Anna LANG.
A part ces, maison d'habitation,
ferme, étables, et jardins, Johannes Thuet et Maria Anna Lang avaient encore 61
arpents de champs, qui furent évalués à 8791 Francs lors du partage.
Après le décès du père Johannes
(1786) un inventaire fut dressé entre Hammerstatt et Rümersheim, concernant le
bétail: 8 chevaux, 27 bœufs, 84 moutons, 33 porcs, 2, chèvres, 28 oies, 36
poules, 32 ruchers; en aliments: 10 Mass de miel, 100kg de lard,
Mais dieu leur fit un cadeau encore plus
riche. Il préserva dans le milieu familiale un profond esprit religieux qui en
inspira les pensées et les aspirations. Cet esprit se transmit comme précieux
héritage et joyau aux descendants, parmi lesquels maints se consacrèrent à la
vocation religieuse. Fasse que ces énumérations et courtes esquisses de vies
des appelés au service de dieu servent à mes lecteurs à leur édification et
peut-être d'exemple à imiter.
Eglise et
presbytère de BETTENDORF